Psychologie et Ethique médicales
Les dispositifs symboliques générateurs de violence dans les situations de soins
Jean-Gilles Boula
Chargé de cours en Sciences Humaines - ISIS (F-Thonon-les Bains) et Webster University - Genève
La violence dans les soins est par certains côtés un sujet tabou car, dans l’opinion courante, l’expression comporte une contradiction dans les termes : violence et soins. C’est oublier en même temps l’extrême difficulté de l’acte de soigner qui articule production symbolique ou langagière et comportements. Qu’elle soit comportementale ou symbolique, la violence trouve son assise, sa préparation, dans des dispositifs dont cet article est l’objet. Ces dispositifs de sens, leur articulation, passent à la trappe d’autant plus facilement que l’illusion de consistance du souci de soigner n’est troublée par aucun soupçon de violence pour mieux asseoir l’évidence de son exclusion supposée de l’univers des soins. Le sens commun, en effet, ne tolère pas la lettre de l’association « soins et violence ». Mais nous savons aussi que le sens commun a l’art de simplifier ce qui s’offre comme complexité, et que personne n’est dupe de ce simplisme tant la pratique des soins est souvent le théâtre des formes de violence qui se trouvent constamment référées à cette nature humaine, au mal qui traverse cette dernière depuis des temps immémoriaux.
Si toute violence suppose un certain rapport au réel, aucune relation de l’homme au réel – (Jacques Lacan nous l’a explicitement appris, après que Freud nous l’eut laissé entendre) – n’est possible sans une médiation symbolique ou imaginaire, seuls registres où se déploie l’ordre du monde ou du réel. Peut-être allons-nous trouver quelque utilité de nous interroger sur le cas particulier de la violence dans les soins.
Trois voies au moins s’offrent à qui veut bien étudier les rapports entre soins infirmiers et violence :
- La première, liée à l’organisation des énoncés et des modalités d’énonciation qui informent les pratiques grosses de comportements violents vis-à-vis des patients. La question de l’engendrement de la violence se trouve donc ici au niveau de la mise en place des manières de parler, de s’adresser aux patients; manières qui, très souvent, se réfèrent à la nature du rapport au savoir, aux certitudes de la pratique empirique (« je sais ce que je fais, et je le fais bien »), et à la signification (« mais qu’est-ce que je fais ?). Cette évocation suffit pour comprendre tout ce qui se trouve mis en jeu dans la pratique des soins, et c’est la raison pour laquelle l’étude de la relation soignant / soigné ne peut faire l’économie de ces deux termes du binôme pratique et "sens" de la pratique. Ainsi nous pouvons nous interroger sur tout ce qui peut faire pont entre la situation des soins, les opinions communément admises (« l’infirmière ou le soignant est une personne gentille par essence, merveilleuse, affable, toujours serviable), et les effets de sens des modalités de communication, ainsi que la possibilité d’événement singulier qu’est la rencontre de l’autre, c’est-à-dire du patient.
- La deuxième voie consiste à se pencher sur la portée des altérations ou modifications du rôle de soignant que ce rapport au savoir introduit, et sur la manière dont ce rôle s’exerce.
- La troisième, enfin, nous indique que toute pratique produit des effets sur la mentalité de ceux et celles qui l’exercent. Dans les soins, le rapport à la mort (ou à l’éventualité de la mort) produit des comportements dont, assez souvent, la violence déployée est analyseur.
La définition la plus immédiate et la moins contestable de la vie n’est pas une définition positive, mais négative : la vie est une propriété que certains actes peuvent abolir. La manière dont peuvent se produire de tels actes pourrait être l’une des préoccupations de la pratique soignante. Toute profession et tout lieu de pratique produisent des énoncés qui rendent compte des actes qui s'y déploient, et le professionnel des soins s’affirme en fonction de la réalité énoncée ou verbale, condition virtuelle de la parole en acte. Or cette réalité verbale, pour un professionnel des soins lui est souvent dictée par la science (biologique, infirmière…) au point de ne se référer au patient qu’à travers elle. Le patient disparaît sous la simple entité biologique comme chose vue et sue. Ainsi biologiser la maladie, c’est la déshumaniser, et déshumaniser la maladie, c’est déshumaniser l’homme. Or l’homme n’est homme que dans l’altérité et la parole (peut-être « altérité de la parole » conviendrait mieux). Si la maladie est affaire humaine, elle se pose comme affaire d’altérité et de la parole.
Il est intéressant de constater que le terme « maladie » en français se traduit dans la perspective anglo-saxonne selon trois vocables différents : disease appartenant au modèle biomédical pour un mauvais fonctionnement des organes ; illness faisant référence aux perceptions, à la psychologie et aux expériences de vie de la personne malade. A cette première différenciation correspondent celles qui distinguent le processus de healing de celui de caring, suivant que la guérison opère au niveau de l’expérience de la maladie ou à celui de l’entité biologique qu’elle représente. Ces deux processus ne sont pas nécessairement superposables, et le troisième terme sickness venant à définir le processus par lequel les signes comportementaux ou biologiques qui accompagnent le disease reçoivent une signification dans le cadre de la culture ou de la société. Pour résumer, nous poserons illness (ce que j’éprouve), disease (ce qu’en dit la science médicale), sickness (le regard social). Ces nuances sémantiques montrent à l’évidence que le malade est le lieu géométrique ou le point de conjonction de modèles interprétatifs, aussi divers que complémentaires, qui pointent vers la singularité de chaque situation de soins. L’infirmière, pour ne parler d’elle, est amenée à concevoir chaque parole énoncée au cours d’un soin comme une parole de circonstance. Chaque propos devient décisif parce que prononcé en un moment décisif, face à un patient singulier. Voici notre hypothèse : la violence est usinée par le genre de paroles qui voit disparaître le patient sous le savoir biomédical ou soignant en homogénéisant les trois dimensions évoquées plus haut pour ne plus en faire qu’une, c’est-à-dire de la biologie ou de la science pure . Enracinées dans la réalité psychologique et sociale, les représentations de la relation soignant / soigné ne sont en rien réductibles aux conceptions médicales du pathologique. Certes, ces conceptions répondent à des questions importantes, mais non à toutes les questions de la réalité humaine. Aussi Claudine Herzlich a-t-elle raison de souligner que « l’importance de la maladie, de la santé, du corps comme objets métaphoriques, comme supports du sens de notre rapport au monde, s’est... considérablement accrue, et le contenu s’en est spécifié ».
La violence interrompt la possibilité de viser un être humain singulier. Comme le dit le philosophe Sylviane Agacinski, « …dans la violence, on substitue sa propre question de l’autre à la question venue de l’autre, ou des autres (car ils sont toujours plusieurs, patients et/ou collègues) ». A se limiter à ne répondre qu’à sa propre question (qui n’est souvent que technique ou biomédicale), on devient un soignant ou une soignante à la responsabilité limitée.
En effet, la question que je me pose sur l’autre est toujours abstraite, loin de l’expérience que je puis avoir avec lui. Aussi le soignant aura-t-il pour objet un être humain malade, souvent sans âge ni sexe, ni jeune ni vieux, bref, un cas qui tombe sous le sens du savoir soignant. Or nous pouvons dire, pour peu que nous fassions un petit effort, que l’expérience avec le malade est une expérience qui est censée toujours livrer à l’altérité, et suppose la réception de quelque chose qui vient de lui et que je n’ai jamais pu prévoir : un don qui m’est fait. C’est pour cela que la question que je puis me poser sur le malade en tant que soignant (la question que je me pose), en prenant la place du don, réduit ce patient à un objet d’un savoir répétitif (cf. schéma 1).
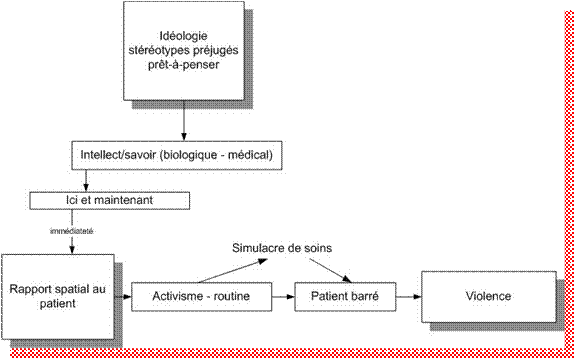
Schéma 1
En revanche, la question de (c’est-à-dire depuis) l’autre, dans la situation de soins, elle, se pose à partir d’une initiale épreuve de l’autre en tant qu’événement singulier , pour reprendre la terminologie du philosophe Alain Badiou. Au cours de cette épreuve, la subjectivité se doit d’être immédiatement partagée et sollicitée avant que le soignant ne s’isole dans un rapport à lui-même et mette ainsi entre parenthèses l’épreuve de la souffrance du patient (de l’autre) pour fonder un faux rapport à ce dernier. Ce rapport n’est alors rien d’autre qu’un simulacre : faire semblant de soigner.
Cette manière de régler mon rapport à l’autre avec moi-même, et non d’abord avec lui, le patient, celui qui souffre, est génératrice de violence. La réduction des seules angoisses de la soignante (réduction dont la violence infligée au patient est la manifestation ponctuelle) occupe le terrain de son activité professionnelle. Ce faisant, le ou la soignante coïncide avec lui-même dans son désir d’autosuffisance à peine voilée, et donc de sa suffisance (au sens moral). C’est ce « je ne veux rien en savoir » qui n’évite pas la violence. Il nous semble qu’entendre la souffrance (dont l’expression ne peut venir que du patient lui-même, et non fantasmée par le soignant) renseigne le pourvoyeur de soins sur la singularité de l’existence souffrante à laquelle il fait face ; entendre la souffrance éloigne de la seule raison législatrice du savoir médical et infirmier dont nous disions qu’il fait disparaître la personne souffrante sous l’arrogance toujours impersonnelle de la routine professionnelle et de la science.
La violence est absolument intransitive : nous entendons par là qu’elle est tributaire d’un passage à l’acte sans aucune médiation, sans question, sans interrogation préalable à propos du patient. Pour déjouer la violence, et pour que le patient ne tombe pas sous la loi du savoir, le soignant doit supposer que le patient est un événement, c’est-à-dire une entité qui comporte un vide, un non-savoir qui atteste sa singularité. Cette approche, le philosophe Alain Badiou la qualifie de « processus générique de vérité », mais d’une vérité toujours provisoire et toujours à faire.
Nous voyons ainsi que la portée anthropologique des soins est évidente, en tant que pratique de l’altérité, c’est-à-dire de l’altération (les deux termes ayant la même origine latine alter, autre). Il s’agit en quelque sorte de déterminer les conditions théoriques et dialogiques dont la réalité de l’autre, maintenu dans sa différence et/ou sa différance (l’acte de différer, c’est-à-dire la différence en acte selon l’analyse pénétrante du philosophe Jacques Derrida), peut être interprétée et respectée sans être coulée dans moule des identités réductrices. Surtout quand le corps et l’âme sont souffrants. En d’autres termes, il s’agit de voir son propre espace de pratiques d’un point de vue extérieur afin de comprendre les présupposés de ses actes et de ses comportements en tan que soignant. Il est en effet difficile pour le soignant de poser l’homme singulier comme objet de soins sans interrogation sur sa vie et ses pratiques propres.
Se demander qui on est, ce que l’on est, d’où l’on vient, ce qu’on fait et avec qui, est la première posture anthropologique qui conditionne les processus d’altération bénéfiques à la relation soigné / soigné. Ces questions, d’apparence naïve, ont un effet sans commune mesure avec leur banalité. De constantes ruptures avec le sens commun, les allants de soi de la vie quotidienne, les évidences délétères (sous forme de stéréotype, de prêt-à-penser idéologiques, de préjugés) dans l’appréhension des phénomènes relationnels, voilà l’incontournable antichambre nécessaire à la compréhension de soi et des autres, en quoi consiste la prophylaxie des phénomènes de violence dans les soins (cf. schéma 2)
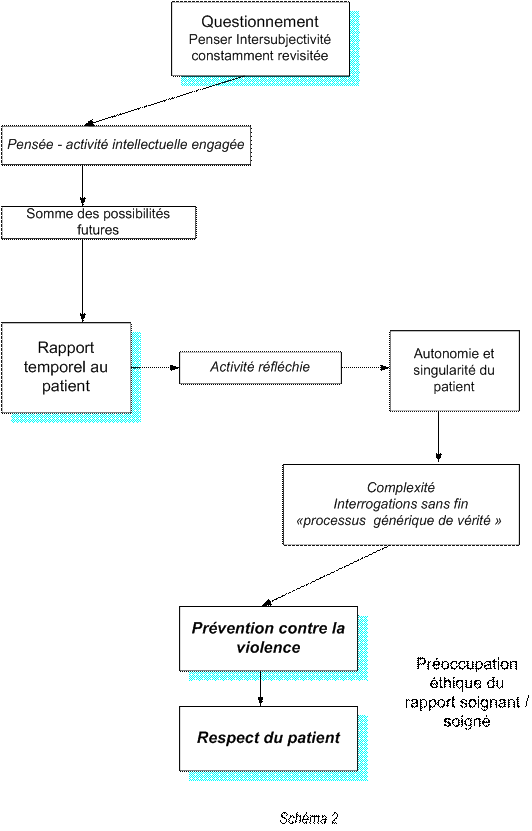
Dans tout discours, il y a des parcelles de violence dès que ce discours fait taire celui du patient ou le barre (quelque maladroit que soit le patient dans l’expression de sa douleur et de sa souffrance), non seulement en fonction des références théoriques de la science médicale et/ou infirmière qui ne se soucient pas souvent de leur ajustement, mais aussi à l’insu du soignant lui-même à partir des dispositions inconscientes qui modulent l’inflexion de ses actes. A la violence de cet intellect impersonnel (au sens de Kant), la soignant doit opposer ce que ressent le patient dans ses variances les plus subtiles, au plus près de l’énonciation des mots, de leur prégnance signifiante et de l’histoire de son corps. Quotidiennement, le soignant (infirmier ou autre) doit se rappeler q u’elle fait face à la souffrance d’une existence : A partir d’une détresse, la malade fait appel à lui, si on sait qu’il n’est pas sourd – et d’ailleurs rien ne nous donne la garantie qu’il pourra introduire l’apaisement souhaité. Cette certitude est destinée à rendre plus circonspectes les positions inflexibles de maîtrise qui tentent souvent les soignants. Relancer, dynamiser, activer la vie du patient, cette existence qui, au sens philosophique, étymologique signifie sortir de soi ; exister, sortir de la « sistence », en quelque sorte la « désistence » et pourquoi pas la résistance ; il s’agit, en effet, que le patient résiste constamment à l’insoutenable lourdeur qu’introduit la maladie dans son corps. Ecouter le patient à partir de ce qui le constitue, de ce qui le définit, écouter sa parole est foncièrement antinomique à la violence des énoncés destinés à faire taire la langue d’un corps particulier ou d’une existence singulière. Ce serait en effet introduire dans la lourdeur de la pierre de tels énoncés la légèreté du questionnement, du langage qui fait qu’on peut encore s’envoler ailleurs. La violence est cette assignation du patient au diagnostic.
La violence, apparente ou dissimulée, est au cœur d’un rapport qui procède des références, indications et contre-indications à partir d’une tradition médicale posant non seulement un diagnostic, mais aussi un pronostic, au détriment de la singularité du patient. Il y a violence dans le savoir soignant, comme dans tout savoir, dès qu’on adopte une posture de soins sans discrimination d’aucune sorte. Il ne s’agit pas de prendre part, ni de s’identifier aux parcelles d’imaginaire proposées par le patient, mais de prendre ce dernier au sérieux comme un être inépuisable, qu’on n’épuise pas par des considérations biologiques ou médicales.
Le rôle professionnel dans les soins est avant tout affaire de conscience (l’amour de ce qui est honorable et noble, l’amour de la grandeur, de la dignité et de la supériorité du caractère individuel), conscience de son incomplétude foncière et constitutive. Si le rôle n’était constitué de cette incomplétude, il se voudrait plein, au sens où l’existence du rôle n’est plus un objet d’interrogations et de questionnements, ce qui se traduirait par l’acceptation des choses telles qu’elles sont et l’activisme qui ne serait alors que l’enchaînement de gestes obsessionnels et mécaniques, d’actions dépourvues de sens. Autrement dit, la reproduction à l’identique de soi, cette conception du rôle qu’est la routine, brise les élans et génère la violence. La violence et le répétitif sont les autres termes définissant l’oubli de l’incomplétude foncière et constitutive du soignant.
Toute une tradition sociale, depuis les débuts de la profession soignante, a pensé le rôle de celui-ci en termes essentiellement moraux et psychologiques : Le soignant s’y est constamment identifié au point que son Moi, sa personnalité est venu entretenir une collusion avec son rôle professionnel. On pourrait être tenté de dire que ce sont de vieilles lunes que cette vision du soignant. Il n’empêche que socialement cette image est la plus répandue ; et il serait étonnant qu’elle n’ait pas d’effets psychologiques dans le comportement du soignant (infirmière ou infirmier) au travail. En fait, la violence se situe dans les deux extrêmes que sont le dévouement total qui obère la réalité psychologique et professionnelle du soignant, et le très peu d’attention qu’on accorde à la situation personnelle de la personne souffrante (Schéma 3).
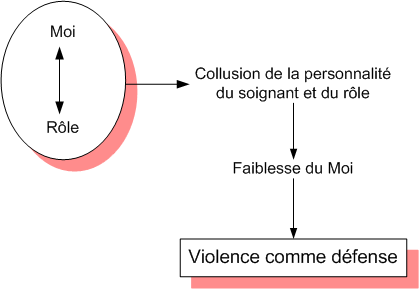
Schéma 3
Certaines dérives du rôle de soignant sont productrices de violence, notamment l’idolâtrie, l’illusion de la reconnaissance, l’autisme, la fusion avec tout le monde, l’orgueil, la vanité, le dévouement, la victimisation de soi. Parcourons ces différentes dérives :
- L’idolâtrie : « je me console de ma vie de soignant (infirmière) médiocre en enregistrant dans le détail toutes les distinctions que reçoivent mes chefs hiérarchiques, je partage leurs satisfactions que j’imagine infinies ». C’est une opération qui ressemble aux tours de passe-passe des illusionnistes qui se soulèvent eux-mêmes par les cheveux (la reconnaissance qui se porte à mon chef ou patron rejaillit sur moi). En d’autres termes, c’est mon idole qui travaille, c’est moi qui en tire les bénéfices. Le rôle est ici une dénégation de soi, c’est-à-dire une violence faite à soi. Et en s’annulant ainsi, le soignant devient agent deb violence faite au patient.
- L’illusion de reconnaissance : « Je m’imagine que les autres me reconnaissent », alors qu’il n’en est rien. Cette illusion, qui fait abstraction et du patient et des soins prodigués pour soulager sa souffrance, est une forme d’égocentrisme qui devient qui devient vite dangereuse pour le patient.
- L’autisme : ici tous les renoncements à toute recherche de reconnaissance sont poussés à l’extrême. Nous définissons l’autisme dans ce contexte comme un refus de tous contacts ou échanges, un emmurement en soi-même, ce qui permet d’écarter tout risque de manquer de reconnaissance ou de ne pas recevoir la confirmation ou non (par les tiers) de sa valeur. L’alcoolisme qu’on rencontre chez certains soignants peut correspondre à un refus d’avoir à rechercher la reconnaissance des autres. Se cacher derrière la carapace de l’indifférence permet évidemment d’éviter les déceptions à venir. Ces attitudes sont parfois interprétées par d’autres comme de l’orgueil ou du mépris, et elles provoquent ainsi, à la suite du rejet initial probablement imaginaire, un rejet réel. C’est le cas typique de la définition persuasive (où la représentation produit la chose représentée).
- La fusion avec tout le monde : cette attitude chez certains soignants à l’égard de la reconnaissance procure ce sentiment océanique où ils ne sont qu’ouverture. Or l’acceptation de l’univers entier oblitère la spécificité des collègues au sein d’une équipe de soins (spécificité des autres rôles). En effet, la fusion avec d’autres rôles ne caractérise pas la condition la condition humaine, que définit au contraire la séparation, le sentiment d’incomplétude qui en résulte. Le rêve de symbiose transforme subrepticement autrui en non-sujet et le menace d’absorption violente, collègues et patients tous ensemble.
- L’orgueil : le renoncement par le soignant à toute confirmation de sa valeur par un jugement extérieur (collègues et patients) et son remplacement par une auto-sanction, une confirmation dont il détient seul le privilège (c’est-à-dire qu’il ne s’abaisse jamais à partager les appréciations de lui-même avec les autres : « J’ai seul le droit de me juger ». Le soignant orgueilleux, c’est un être auto-suffisant (pour ne pas dire suffisant) qui se rêve en « dieu ». Cette dérive du rôle où de l’ensemble des actes ne peut aboutir qu’à un appauvrissement du Soi (de soi) et à l’hétéronomie, générateur de violence.
- La vanité : « Je me loue moi-même, mais je veux toujours plaire à autrui à partir de l’idée que je me fais de moi-même », dit le soignant. Nous sommes en présence d’une oblitération des autres, forme courante de violence vis-à-vis des collègues, et par ricochet, vis-à-vis des patients.
- Le dévouement : c’est le soignant qui ne demande rien, qui se propose de donner sans contrepartie. En effet, il pratique une psychologie simpliste : il fait comme si l’autre (la patient) avait besoin de vivre seulement, mais non d’exister, de recevoir mais non de donner, empêchant ainsi l’autre de se sentir nécessaire. Nous savons aujourd’hui que, psychologiquement, s’occuper des besoins des autres, c’est oublier souvent les siens propres, au risque d’un retour violent du refoulé, et de lester les patients du stigmate d’ingratitude.
- La victimisation : autre forme assez courue de renoncement à la reconnaissance. Elle consiste en le sentiment du soignant d’être la victime de l’inattention de ses autres collègues (« Je m’apitoie sur moi-même, et cette auto-gratification me console de tous les revers subis »). Il faut ajouter qu’en réalité, le soignant n’aspire pas à subir le sort de la victime, la victimisation de lui-même impliquant ici la culpabilisation d’autrui, autre forme de violence.
Le rappel de ces dérives du rôle professionnel n’a pas pour visée de prêcher la vertu, mais essaie de rendre le professionnel des soins attentif aux effets délétères, néfastes, qu’elles peuvent produire sur la personnalité du soignant.
Quels sont ces effets? Notamment l'exposition et la fragilisation de la personnalité du soignant qui, au lieu de se différentier, de s'autonomiser en prenant distance vis-à-vis de son rôle, ne cesse de se prendre pour ce rôle. En d'autres termes, au lieu de se prêter au rôle, il s'y adonne. Or, se prêter au rôle ne peut se concevoir que dans une posture critique vis-à-vis de celui-ci. Ce qui revient à dire qu'au cœur de toute pratique, il y a un vide situé qui justifie la critique du rôle. L'incomplétude constitutive du rôle troue ainsi en permanence les avoirs établis et devient la seule source connue de savoirs nouveaux. La vérité de la profession soignante consiste donc en une rupture qui, venant à bout des stéréotypes et autres images figées, fait retour vers l'immédiat de la situation soignant / soigné, en remaniant cette sorte d'encyclopédie portative dans laquelle puisent la doxa, les opinions courante, les fausses communications et la socialité convenue de clichés (soignant) à clichés (patients). (Schéma 4).
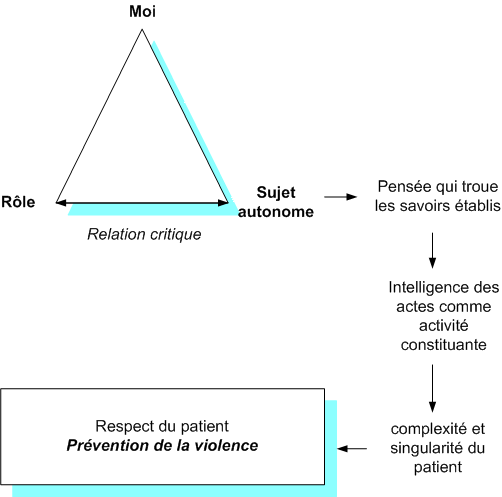
Schéma 4
Si le rôle professionnel du soignant implique de puissants remaniements des formes de discours, de communication et de savoirs, la violence dans les soins a essentiellement trois causes:
- Imaginer que l'événement que constitue la pratique soignante et le patient convoque non le vide, mais le plein de la situation des soins (simulacre): la violence comme terreur.
- Faire abstraction de la critique du rôle, ou la négliger, institue la violence comme manifestation de la trahison et de l'affaiblissement de la personnalité du soignant.
- identifier la patient à un pur et simple savoir scientifique génère la violence comme désastre de la pratique soignante.
Comme aimait à le dire le psychanalyste Jacques Lacan "La maladie, c'est le mal à dire; et être malade, c'est être malade de ne pouvoir parler parce que la parole est enchaînée, sans lieu ni espace pour s'exprimer". Autant dire que la souffrance sera d'autant plus grande que le patient fait face à un dispositif de pensées bloquées, où viennent s'échouer ses interrogations existentielles, les questions métaphysiques, philosophiques et très souvent théologico-religieuses qui le hantent.
Nous savons aujourd'hui que les traitements biomédicaux n'ont à eux seuls que peu d'effets sur les souffrances psychologiques du patient, souffrances qu'accentuent les préjugés, les sophismes et tout l'arsenal de pensées toutes faites. Nous avons aussi des exemples de ce genre de formulations aussi rigides que monolithiques:
Ø " Le SIDA est apparu au moment où l'homme s'est détournée de la foi chrétienne". Terrible sophisme, car aucun rapport logique, encore moins établi, entre les deux phénomènes; l'un n'est logiquement pas la cause de l'autre. Une telle fausse causalité est inacceptable, c'est précisément en cela qu'elle est violente.
Ø "Ne soyez pas trop demandeur avec moi cette nuit" dit une infirmière ou un infirmier, "car en tant que femme mariée (ou homme marié) je travaille toute la journée". Une personne peut en effet mener une vie difficile au plan personnel, cela ne change rien aux conditions qu'elle doit remplir.
Ø "L'inégalité entre les personnes est inévitable, puisqu'elle existe depuis la nuit des temps". Une chose peut être en effet très ancienne, cela ne la rend ni bonne ni inévitable, car nous ne pouvons prévoir l'avenir.
Il existe une liste inépuisable de tels sophismes: Nous retiendrons seulement que la pensée n'est féconde que quand elle crée des possibilités, tant personnelles que sociales, car la maladie demeure un phénomène qui déborde de toutes parts la situations de soins.
Face à la violence, la médiation imaginaire et symbolique de la religion avait pu longtemps sublimer son expression. Mais, de nos jours, la pratique religieuse est moins prégnante qu'auparavant. Tout se passe donc comme si pour le soignant plus rien ne pouvait venir médiatiser son rapport à la violence de la mort, violence à laquelle le soignant fait face quotidiennement. Peut-être le temps se rapproche-t-il très vite où les infirmières (infirmiers) et les médecins seront chargés de produire aux hommes la mort idéale: Après tout, tel est le vrai sens de l'euthanasie, après bien des renâclements. Lorsque les soins se laissent engrosser par la science, l'abstraction dont est frappé le corps se traduit dans sa rigidité des pensées toutes faites et des sophismes à l'origine des violences directes ou indirectes, physiques, symboliques, psychologiques ou morales.
Nous avons essayé de faire état des grammaires très subtiles des dispositifs générateurs de violence: dispositifs langagiers (langage social, parole individuelle), dispositifs de rôles (rôle hétéronome, rôle autonome), dispositifs inconscients et conscients face à la mort (rôle du savoir et rôle de la pensée, mécanismes de défenses face à l'angoisse suscitée par la maladie). Une attention particulièrement alertée aux inflexions portées à ces dispositifs nous sert d'antidote à la violence si fréquemment vécue dans les situations de soins.
Bibliographie
- Agacinski, Sylviane: Critique de l'égocentrisme, Ed. Galilée, Paris, 1997.
- Arendt, Hannah: La vie de l'Esprit (La Pensée), Tome 1, PUF, Paris, 1981.
- Arendt, Hannah: La vie de l'Esprit (Le Vouloir), Tome 2, PUF, Paris 1983
- Arendt, Hannah: Considérations morales, Ed. Payot et Rivage, Paris, 1996.
- Augé, Marc, Herzlich, Claudine: Le sens du Mal (Anthropologie, Histoire, Sociologie de la maladie), Ed. des Archives Contemporaines, Paris, 1991.
- Badiou, Alain: L'Être et l'Evénement, Ed. du Seuil, Paris, 1988.
- Badiou, Alain: L'Ethique (Essai sur la Conscience du Mal), Ed. Hatier, Paris, 1993.
- Gusdorf, Georges: La parole, PUF, Paris, 1972.
- Ricoeur, Paul: Revue Autrement: Article "La souffrance n'est pas la douleur", Ed. Autrement, Paris, 2001.